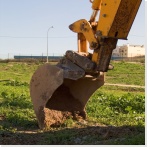 Aujourd'hui, aucune communauté n'a les moyens d'ignorer la valeur du capital naturel pour prendre des décisions de développement. Prendre des décisions de développement économique, (au-delà du syndrome de la "pepine")* c'est amorcer des choix dont les impacts pour l'avenir des communautés impliquées sont nombreux. Il y a certes les impacts à court et moyen terme. Ceux-ci sont largement évoqués : la création d'emplois, les investissements directs et indirects, l'effet de levier économique sur les activités socio-économiques de la communauté, l'impact sur « l'humeur » ou l'effet de stimulant la perception de dynamisme d'un milieu. Si le projet est caractérisé par la mise en valeur d'une technologie d'avant-garde, cet effet sur « l'humeur » pourra être d'autant ragaillardi, car les perspectives de retombées indirectes sur l'éducation et la recherche pourront s'en trouver améliorées. Voilà pour une courte revue des impacts les plus couramment utilisés.
Aujourd'hui, aucune communauté n'a les moyens d'ignorer la valeur du capital naturel pour prendre des décisions de développement. Prendre des décisions de développement économique, (au-delà du syndrome de la "pepine")* c'est amorcer des choix dont les impacts pour l'avenir des communautés impliquées sont nombreux. Il y a certes les impacts à court et moyen terme. Ceux-ci sont largement évoqués : la création d'emplois, les investissements directs et indirects, l'effet de levier économique sur les activités socio-économiques de la communauté, l'impact sur « l'humeur » ou l'effet de stimulant la perception de dynamisme d'un milieu. Si le projet est caractérisé par la mise en valeur d'une technologie d'avant-garde, cet effet sur « l'humeur » pourra être d'autant ragaillardi, car les perspectives de retombées indirectes sur l'éducation et la recherche pourront s'en trouver améliorées. Voilà pour une courte revue des impacts les plus couramment utilisés.
Il existe un autre volet qui ne fait jamais l'objet de préoccupation, il s'agit de l'impact qu'aura un projet sur la valeur du capital naturel. Sauf pour des cas d'études ou de recherches académiques, jamais un décideur ou un représentant politique ou un dirigeant d'entreprise n'a l'instinct et la préoccupation d'utiliser systématiquement la valeur du capital naturel ou des services écosystémiques afférents, dans le but d'améliorer le processus de prise de décision et la pertinence d'un projet.
Plusieurs raisons appuient la nécessité de se préoccuper de la valeur du capital naturel, d'abord, la fragilité de plus en plus grande de nos écosystèmes. Selon le PNUE, 60 % des écosystèmes de la planète ont soit atteint une dégradation irréversible, ou sur le point de le devenir. « Au cours des 50 dernières années, l’Homme a généré des modifications au niveau des écosystèmes de manière plus rapide et plus extensive que sur aucune autre période comparable de l'histoire de l’humanité, en grande partie pour satisfaire une demande à croissance rapide en matière de nourriture, d'eau douce, de bois de construction, de fibre, et d’énergie. Ceci a eu pour conséquence une perte substantielle de la diversité biologique sur la Terre, dont une forte proportion de manières irréversibles ». (1) De plus, la perte de biodiversité associée à la pression que nous exerçons sur les territoires (ex : les milieux humides), sur l'eau et l'air (émission de GES) contextualise l'importance de nous préoccuper de notre capital naturel. Aussi, évaluer la valeur du capital naturel et des services écosystémiques permet d'inviter la terre à la table des décideurs afin d'éclairer davantage les impacts à long terme des projets qu'ils évaluent. En cela, rien n'est contraire aux préceptes du développement durable ou encore de la Responsabilité sociale en entreprise (RSE).
Mais qu'est-ce qui fait hésiter les décideurs? À l'heure ou la communauté économique européenne réfléchit à étiqueter comme «plus polluant» le pétrole synthétique provenant de l'exploitation des sables bitumineux, il faut comprendre qu'aussi longtemps que nous allons ignorer cette réalité, nous ferons de plus en plus face à ce type de «menace». Il nous faut alors tenir compte de la volonté des marchés de consommation, plus conscients des impacts écologiques au long du cycle de vie d'un produit. Nier cette réalité nuira certainement à moyen terme. Une autre source d'hésitation pourrait être l'ignorance concernant les méthodes d'évaluation du capital naturel? Il existe beaucoup de méthodes, bien répertoriées et testées ; même que certains États états-uniens ont procédé à des exercices d'évaluations afin de commencer à introduire cette importante variable dans leurs décisions de planification du territoire. (2) Au Canada les initiatives d'évaluation sont le fait d'organismes non gouvernementaux. Canard Illimité en 2004 (3) Institut Pembina et initiative boréale en 2005 (4) sont des exemples.
Cette question est maintenant devenue existentielle et urgente. D'autres réclament aussi des changements dans notre manière d'évaluer et de prendre en compte les vrais impacts des projets de développement. Il est temps et urgent de procéder aux changements! (5)
Dans le prochain article, je présenterai succinctement les différentes méthodes d'évaluation et leurs impacts dans la prise de décision.
Voir : La valeur des écosystèmes – une nouvelle culture à acquérir! Note : * Le syndrome de la «pepine» (pelle mécanique) fait référence à l'empressement habituel des décideurs de voir de l'action rapidement sur le terrain, dès l'annonce d'un projet. Sources : 1. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC. 2. Voir un résumé de l'étude d'évaluation du capital naturel du New-Jersey disponible en cliquant ici. 3. Olewiler, N. (2004). La valeur du capital naturel dans les régions peuplées du Canada. Publié par Canards Illimités Canada et Conservation de la Nature Canada, 37 p 4. Anielski, M., et Wilson, S., (2005). Évaluation de la valeur réelle du capital naturel et des écosystèmes boréaux du canada. Ottawa, Institut Pembina et Initiative Boréale canadienne, 90 p. 5. Voir à ce sujet la sortie publique d’éminents scientifiques et économistes. "Top scientists urge end to policy and governance failures to tackle social and environmental crises". 2012. Communiqué provenant de International Institute for Environment and Development, site Internet visité le 22 février 2012. http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/biodiversity-and-conservation/top-scientists-urge-end-policy